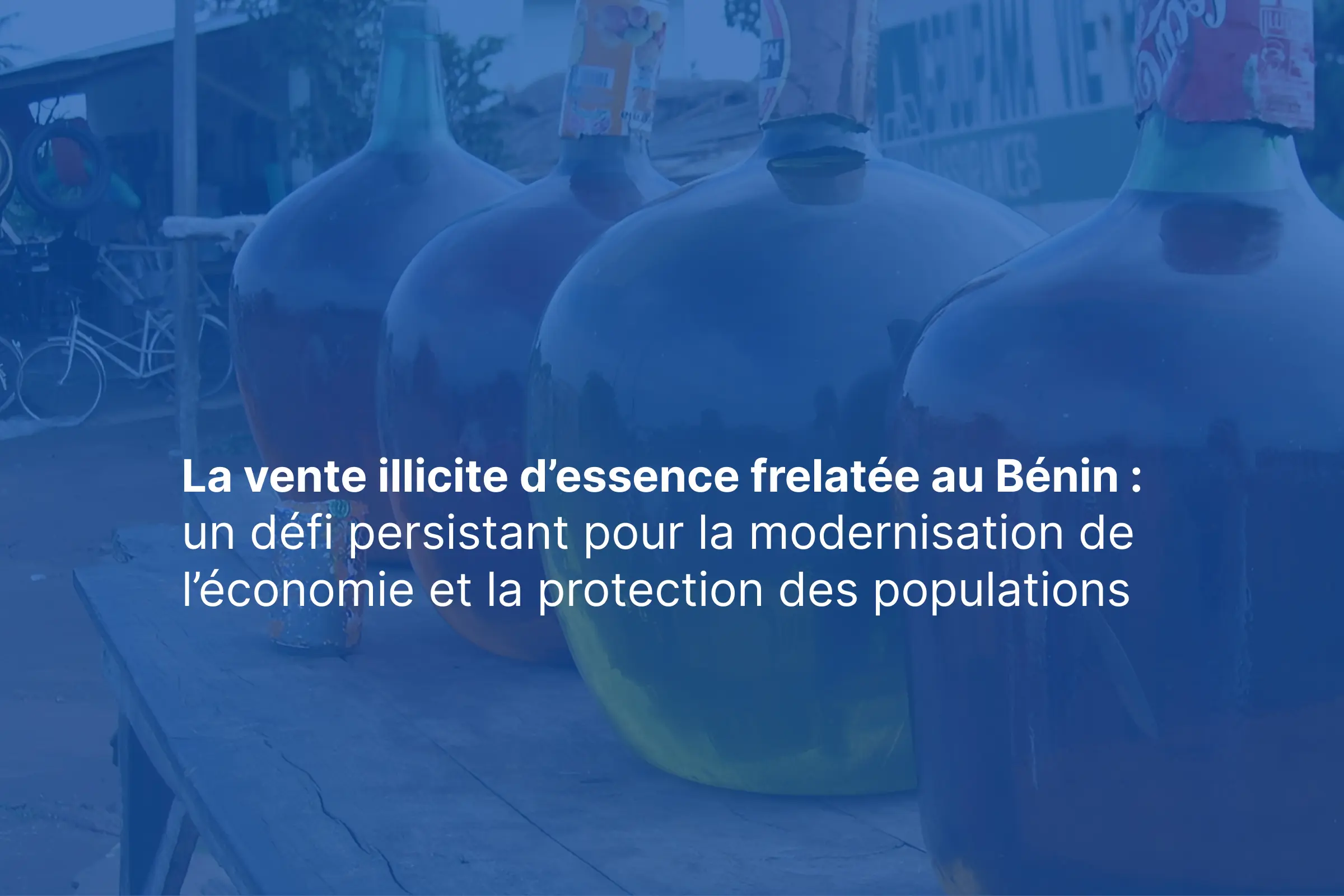La crise économique qui a durement frappé le Bénin dans les années 1980 a créé une nouvelle dynamique sociale. Le chômage et l’arrêt des recrutements dans la Fonction Publique et les Programmes d’Ajustements Structurels (PAS) de 1989 ont contribué à l’éclatement du tissu familial qui, auparavant, était plus uni et solidaire. Il faut désormais pour survivre se battre rudement dans un environnement où la cherté de la vie et la satisfaction des besoins fondamentaux sont devenues de véritables casse-tête. Beaucoup de personnes en quête d’emplois se replient sur des activités informelles. Le manque d’alternatives d’insertion professionnelle augmente le manque d’emplois et de chômage conduisant à l’exercice d’activités non conformes aux cadres réglementaires en vigueur dans un pays. En conséquence, une partie de la population se trouve contrainte de recourir, au quotidien, à des activités économiques informelles ou marginales, telles que la mendicité, la prostitution, le vol, la fraude ou d’autres pratiques déviantes. Ces activités, souvent illégales ou moralement contestées, traduisent un manque d’alternatives économiques viables et une fragilisation du tissu socio-économique. La vente illicite de carburant dans le secteur informel constitue une activité à haut risque, mais fortement développée au sein de l’économie béninoise, en raison notamment de la proximité géographique avec le Nigeria, principal fournisseur de carburant subventionné. Le pétrole est une des ressources naturelles les plus recherchées au monde. C’est un produit de première nécessité. Une attention particulière lui est accordée à cause de l’utilité de ses dérivés dans plusieurs domaines tels que l’énergie et le transport. Il apparaît donc comme un enjeu stratégique, économique et politique. C’est d’ailleurs ce contexte qui justifie les explorations pétrolières menées depuis plusieurs décennies sur les côtes béninoises par l’État, avec pour ambition que le pays rejoigne, d’ici fin 2025, le cercle des producteurs de pétrole.
À ce jour, le Bénin demeure un pays essentiellement consommateur et importateur de produits pétroliers, qu’il acquiert sur le marché international par l’intermédiaire de sociétés agréées. Cette dépendance expose l’économie nationale à des variations fréquentes et parfois importantes des prix, notamment en cas de tensions sur les marchés mondiaux.
C’est partant de là que la vente illicite de l’essence aux abords des voies, communément appelée « Kpayo », s’est développée au Bénin. Ce carburant vendu dans le secteur informel provient de la République Fédérale du Nigéria, pays voisin avec lequel le Bénin partage plus de 773Km de frontières et grand pays producteur et exportateur de pétrole (1 485 000 barils/jour), où l’essence coûte moins cher à la pompe. La population béninoise exploite la proximité de ce grand pays producteur Africain de pétrole, pour importer illégalement l’essence, suivant un circuit de redistribution propre à elle pour la céder à des prix relativement bas, comparés à ceux pratiqués dans les stations-service agréées. Ce circuit est donc parallèle au circuit officiel alimenté par les sociétés agréées.
La vente illicite de l’essence est devenue très inquiétante non seulement pour les sociétés agréées, mais aussi pour l’Etat qui selon des estimations fait perdre au Trésor Public près de 20 milliards de francs CFA en moyenne par an. Les stations-service n’arrivent pas à satisfaire la demande des consommateurs sur toute l’étendue du territoire national qui doivent veiller pour se procurer du carburant et ceci à un prix relativement plus élevé.
Face à cette situation, les consommateurs n’ont d’autres issues que de se tourner vers les vendeurs illicites de proximité d’essence frelatée installés aux bords des voies publiques. Ils offrent quotidiennement une trilogie formidable qui favorise et encourage les consommateurs à venir toujours vers eux, même si au passage le prix connaît une légère hausse, c’est: bon prix-proximité-rapidité; des qualités qu’on ne retrouve pas dans les stations-service agréées.
Sommaire
Est-ce une raison suffisante malgré les risques liés à cette activité ?
Depuis l’apparition de la vente informelle du carburant, les acteurs à divers niveaux sont exposés à d’énormes risques d’insécurité aussi bien dans son importation, sa commercialisation que dans sa consommation. Plusieurs incendies avec d’énormes dégâts matériels et des dizaines de pertes en vies humaines ont été enregistrés ces vingt dernières années dans ce secteur d’activité. Il y a aussi la pollution de l’environnement dans les grandes villes qui, selon les autorités compétentes, est largement imputée à l’usage de carburant impropre provenant du Kpayo. Mais, compte tenu du rôle important et des problèmes vitaux que règle ce commerce illicite, les différents acteurs pensent d’abord à la satisfaction de leurs besoins, de ceux de leurs familles et alliées qui sont à leur charge. En conséquence, toutes les actions que l’Etat béninois a engagées pour interdire la vente du Kpayo ont rencontré jusqu’ici une résistance très forte au changement sans incidence sur l’expansion du commerce.
Quels sont les dommages engendrés par la vente illicite de l’essence frelatée au Bénin ?
Plusieurs incendies dus à la vente illicite de l’essence frelatée ont frappé le Bénin ces dernières années. En 2007, nous pouvons citer entre autres les drames de Porga, d’Akpakpa à Cotonou et de Cachi à Porto-Novo. Le 27 mai 2008, nous pouvons citer celui survenu au stade de l’amitié Mathieu KEREKOU de Cotonou et celui de Fidjrossè faisant quatre personnes brûlées le 12 janvier 2009. En septembre 2023, le Bénin a enregistré l’un des incendies le plus meurtriers de l’histoire où un entrepôt d’essence frelatée situé en pleine agglomération à Sèmè-Kraké a pris feu, faisant 40 morts dont 2 bébés, une vingtaine de blessés et d’énormes dégâts matériels.
Source : Incendie de Sèmè-Kraké, septembre 2023
S’agissant d’un secteur informel, ces différents incendies sont suivis de beaucoup d’autres moins importants et non officiels dans tout le pays avec plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels à leur solde.
Quels sont les efforts de l’État béninois pour pallier la vente illicite de l’essence frelatée ?
Ces dernières années, le secteur de la distribution des produits pétroliers au Bénin a connu une transformation remarquable. En effet, jusqu’en 2016, le Bénin ne comptait que 175 stations-service dont 64% sont réparties dans 17 communes sur les 77 que compte le pays. De 2016 à 2023, le nombre de stations-service formelles et aux normes a explosé pour atteindre 321, soit une augmentation de 83,43% par rapport à 2016. Cette croissance significative témoigne de la modernisation et de l’attractivité accrue du secteur. Cette dynamique est le fruit de plusieurs mesures phares mises en place par le gouvernement. Parmi ces réformes, l’institutionnalisation de l’agrément en ligne a été cruciale. Elle a permis de simplifier et d’accélérer le processus d’octroi des autorisations nécessaires, passant d’une durée de traitement de 180 jours à 30 jours seulement. Aussi, la suppression de l’exigence de capital social de 300 millions de francs CFA, auparavant un frein majeur, a facilité l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Il faut préciser que l’augmentation du nombre de stations-service a permis de réduire considérablement les longues files d’attente devant les rares stations fonctionnelles.
En plus des 321 stations-service, le Bénin a lancé un programme pilote de mise à disposition des vendeurs du secteur informel, 5 000 mini-stations pour permettre une régulation plus pacifique et sans heurts. L’objectif de cette initiative est de mettre fin aux incendies et aux dégâts causés par l’essence de contrebande, en fournissant des infrastructures adéquates pour la vente de produits pétroliers.
Face à un problème public complexe, de type wicked problem, tel que celui de l’essence kpayo, le recours à des programmes pilotes constitue une approche sûre de transformation et d’innovation publique durable. À l’image d’un vaccin, l’État béninois conçoit une solution, la teste à petite échelle, puis l’élargit en politique générale si les résultats sont concluants, ou procède à des ajustements le cas échéant. Cette méthode illustre une forme de gouvernance par l’innovation sociale, que le Bénin adopte avec rigueur scientifique pour soutenir sa croissance et renforcer sa résilience.
Une politique de reconversion énergétique au service de l’emploi et de la modernité
Avec le développement continu de l’agriculture et la montée des besoins de modernité, le Bénin dispose d’une opportunité unique pour transformer progressivement l’activité de vente illicite d’essence en un secteur structuré et porteur. Les points de vente actuels pourraient, par exemple, évoluer vers des épiceries de proximité multiservices, intégrant la distribution d’autres produits essentiels. À l’image des aires de repos modernes, ces espaces deviendraient des leviers d’attractivité économique et de durabilité dans la reconversion.
Parallèlement, les acteurs du secteur pourraient être formés progressivement aux métiers du “vert” et des énergies renouvelables, dont le potentiel de création d’emplois est immense sur le continent. Dans un contexte où les projets énergétiques se multiplient au Bénin, cette reconversion représenterait un véritable potentiel d’absorption vers des emplois légaux et pérennes pour des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes.
Mieux encore, en développant des filières de formation adaptées, le Bénin pourrait non seulement répondre à ses besoins internes, mais aussi devenir un pôle régional de compétences, capable de former des milliers de jeunes au service des économies de la sous-région.
Références
GI-TOC. (2024). Le Bénin introduit des mini stations-service pour s’attaquer aux chaînes d’approvisionnement en carburant illicite et aux groupes armés
Portail national des services publics. Délivrance d’autorisation de construction des stations-serviceKORIACTU. (2023). L’essence kpayo au Bénin : une équation à plusieurs inconnus
Par Gérald AMAHOWE | Analyste en innovation sociale à Africitizen