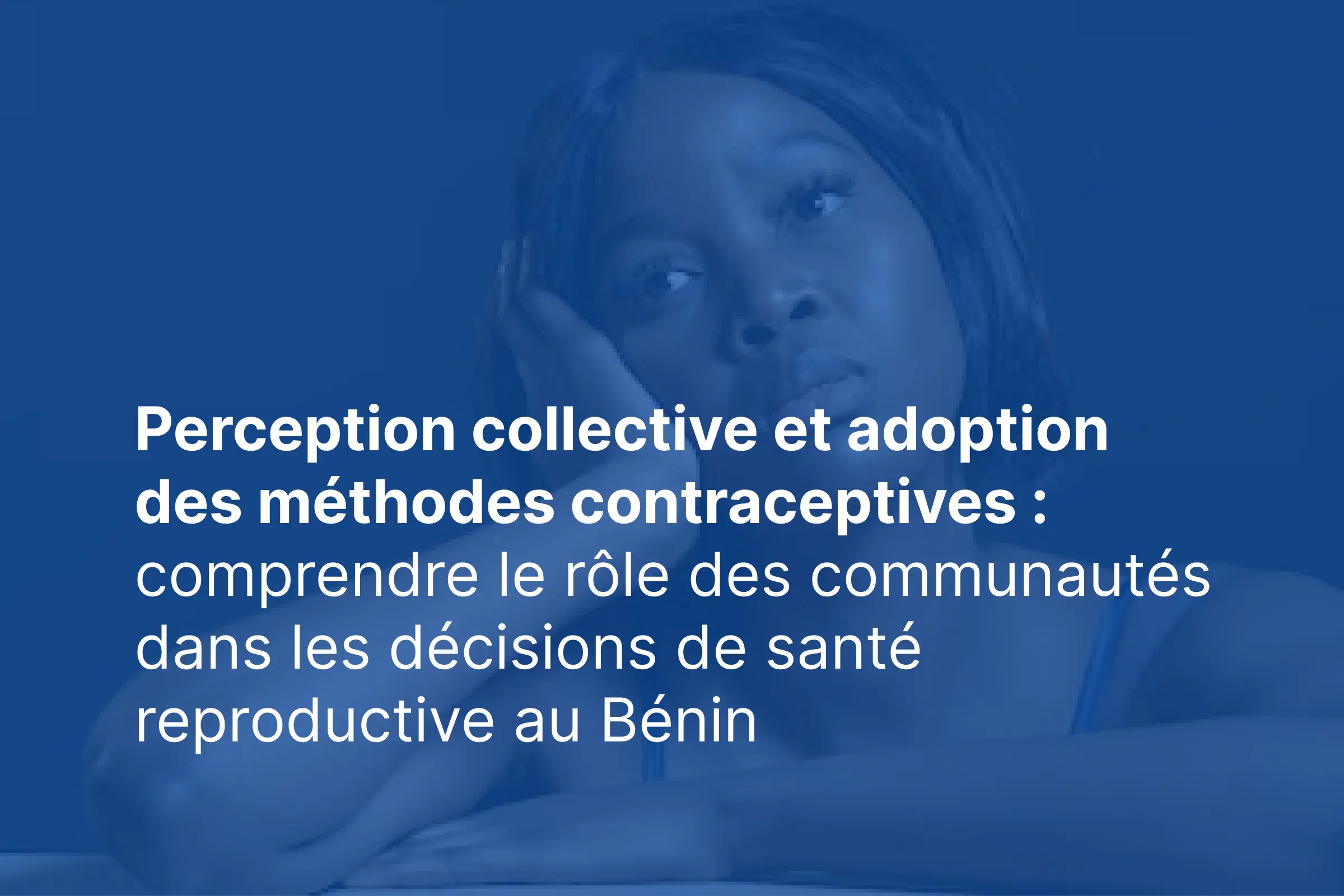Au Bénin, malgré les efforts des autorités et des partenaires de santé, la contraception moderne peine à s’imposer. Derrière les chiffres d’usage encore faibles se cachent des perceptions communautaires inquiétantes, mêlant croyances religieuses, normes sociales et pressions familiales. Dans ce contexte, comprendre le rôle des communautés devient essentiel pour favoriser une adoption plus large et plus inclusive des méthodes contraceptives.
Imaginez une horloge qui ne s’arrête jamais. Chaque jour, l’Afrique accueille plus de 48 000 nouveau-nés. Ce rythme effréné, 2,26 % de croissance annuelle, est le plus rapide au monde. Le déséquilibre persistant entre l’accroissement élevé de la population et la croissance économique contribue à la détérioration des conditions de vie des ménages. Une des priorités des pouvoirs publics est de mettre en place des stratégies adéquates pour une maîtrise efficiente de l’expansion démographique sans levier économique à la hauteur. La fécondité, comme composante majeure de cette évolution, est au centre de toutes les préoccupations.
Au Bénin, malgré les actions entreprises, le niveau de la fécondité reste encore parmi les plus élevés au monde et est évalué à 4,97 enfants par femme (INSAE, 2021). Cela veut dire que si toutes les femmes au Bénin avaient le même nombre d’enfants, chacune aurait en moyenne 5 enfants à sa charge. Pour répondre à ce défi, le Gouvernement Béninois a opté pour une approche structurée et plus complète par la prise en compte de la dimension population dans tous les plans et programmes de développement. Cette orientation a été consolidée par la Déclaration de Politique de Population, dont l’objectif est d’atteindre l’équilibre entre l’accroissement de la population et le développement socio-économique, adoptée en 1988 et actualisée en 2001 par le Gouvernement du Bénin, après l’adoption en 1980 du concept de «bien-être familial » incluant la protection maternelle et infantile et la planification familiale. La République du Bénin a fait de la promotion de la planification familiale une priorité nationale, inscrite dans le cadre de l’effort de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Outre la prévention des décès, l’accroissement de la pratique de la contraception aiderait les femmes et les familles à limiter leur nombre d’enfants à celui désiré et à mieux maîtriser le moment de leurs grossesses et naissances. Elle aiderait le Bénin à atteindre ses objectifs de développement durable, notamment en réduisant la pauvreté, en améliorant les niveaux d’éducation, en augmentant les revenus des femmes, la scolarisation des enfants et le PNB par habitant.
Sommaire
Que disent les statistiques sur l’adoption de la contraception moderne au Bénin ?
En 2012, la pratique contraceptive moderne restait limitée. Seuls 7% des femmes mariées et 23% des célibataires sexuellement actives adoptaient les méthodes contraceptives modernes (DME-MS, 2016). En 2013, le gouvernement du Bénin s’est fixé l’objectif de doubler la prévalence de la contraception moderne, en la portant à 20% à l’horizon 2018 (DSME-MS, 2013). Il a entrepris à cette fin de vastes campagnes d’information et de sensibilisation et une meilleure intégration de la planification familiale dans les autres services de santé reproductive tels que les centres de promotion sociale et les centres de santé. À ces stratégies s’est ajouté les démarches de promotion de la planification familiale par de nombreux groupes de la société civile et organisations internationales. Malgré les efforts politiques soutenus du pays et les enquêtes révélant qu’un nombre grandissant de Béninoises désirent moins d’enfants, le pourcentage des femmes en âge de procréer qui utilisent les méthodes contraceptives modernes n’a pas atteint 15% (EDS IV-INSAE, 2018). Parmi les femmes mariées 33% désirent différer ou limiter leurs grossesses, mais ne pratiquent pas la contraception (EDS IV, 2018). La proportion des naissances non planifiées est par conséquent assez élevée, chiffrée à 23% en 2017-2018 (EDS IV-INSAE, 2022). Par ailleurs, les résultats de l’Enquête Démographique de Santé au dans la sous-région Ouest Africaine au Mali, précisent que la connaissance des méthodes contraceptives en milieu urbain (80%) est supérieure à la connaissance en milieu rural (60%) et que le niveau de pratique des méthodes contraceptives traditionnelles, bien que toujours faible, est presque trois fois supérieur à celui de la pratique de la contraception moderne (EDS-Mali, 2012). Cette réalité présente dans plusieurs pays en développement ne fait donc pas exception au Bénin où l’impact du milieu de résidence sur la pratique de la contraception moderne est très net.
Quand les perceptions communautaires freinent la planification familiale
Dans beaucoup d’études antérieures, plusieurs facteurs ont été identifiés comme principales raisons de la non adoption des méthodes contraceptives modernes. Plusieurs auteurs expliquent l’importance de cette diversité de perception sur la décision d’utiliser des contraceptifs médicalisés. Ainsi, les hommes et les femmes n’apprécient pas de la même manière l’importance d’un recours à la contraception moderne et même entre les femmes les avis divergent. De l’autre côté, l’environnement social et les croyances religieuses sont des facteurs importants à prendre en considération.
La religion occupe une place importante dans la vie des populations béninoises avec 27,7 % de Musulmans , 25,5 % de catholiques romains et 13,5% de protestants , 11,6% de Vodoun , et 9,5%autres chrétiens. Ainsi, les attitudes et la position de chaque ménage en matière de procréation sont fortement influencées par les enseignements religieux. La fécondité est considérée comme une prescription divine et le mariage comme une institution divine. Ce qui implique que les hommes sont libres de s’unir et de procréer. « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes.» (Genèse 1 : 28). Telle est la volonté de Dieu car après la création du couple, il leur assigna la mission de transmettre la vie par une procréation responsable.
Mais qu’entend-t-on par procréation responsable ? La procréation responsable sous-entend un contrôle des naissances en fonction de la capacité du couple c’est-à-dire de l’homme et de la femme à s’en occuper. Dans toutes les sociétés africaines, il n’est pas nouveau d’entendre dire qu’elles sont régies par les valeurs normatives. Chaque société a ses valeurs culturelles, qui se distinguent les unes des autres. Cette diversification de cultures dans les sociétés africaines entraîne de diverses positions en matière de fécondité. En général, les sociétés africaines et particulièrement celles du sud du Sahara désirent des grandes familles. Les femmes ayant une progéniture nombreuse sont généralement l’objet d’un grand respect ou d’une haute considération de la part de la société. Sala-Diankada (1988, p.45) note à cet effet qu’«étant donné qu’en Afrique, l’infécondité cause, depuis la nuit des temps, une peur profonde, voire atavique, tout est mis en œuvre tant par le couple que par les belles familles, pour éviter au mariage, plus précisément à la femme mariée, la honte due à l’absence de l’enfant».
Une étude effectuée au Nigeria a montré par ailleurs que le peu de femmes innovatrices ayant eu l’idée d’exiger leurs droits en matière de la limitation de leurs naissances paraissent aux yeux de leurs beaux-parents et beaucoup d’autres personnes monstrueuses. Parce que selon la culture africaine, la femme n’a pas droit à décider de sa fécondité. Ce droit est exclusivement réservé au mari ou encore à certains membres de la famille de l’homme. (EDST-II, 2004).
Au Tchad, lors de l’analyse approfondie de l’EDST-II, M. F. Banhoudel ((2007) a expliqué que: «le contrôle de la fécondité à travers l’utilisation de la contraception est entravé par certains facteurs socio-culturels et démographiques. Pour cet auteur, les résultats de l’analyse variée des facteurs explicatifs de l’utilisation de la contraception ont permis de dégager trois facteurs hautement significatifs qui semblent être les principaux obstacles à la Planification Familiale au Tchad: la mortalité des enfants, le faible niveau d’instruction des femmes et le fait de résider en milieu rural».
Changer les mentalités autour des méthodes contraceptives au Bénin : quelles actions concrètes ?
Les jeunes tout comme les adultes hésitent à utiliser des méthodes contraceptives modernes par crainte d’être jugés ou stigmatisés par leur communauté. En effet, la contraception est souvent perçue comme incompatible avec les valeurs religieuses ou morales, ce qui engendre une sorte de pression sociale qui décourage son adoption. Par ailleurs, des rumeurs et des mythes circulent largement concernant les effets secondaires des contraceptifs.
Pour surmonter ces barrières, il est essentiel de renforcer les programmes de sensibilisation communautaire et d’éducation reproductive. À cet égard, les écoles et les organisations de la société civile peuvent être des vecteurs puissants pour diffuser des informations factuelles sur les méthodes contraceptives modernes, leurs avantages et leurs effets secondaires réels. Il faut aussi développer des messages permettant d’augmenter le pouvoir de la femme dans l’adoption de la contraception et faciliter l’accès aux méthodes contraceptives.
Et si on parlait aussi aux hommes ? Vers une approche inclusive de la contraception en Afrique
Face aux perceptions collectives autour de l’adoption des méthodes contraceptives, il apparaît clairement que nous sommes confrontés à un problème public complexe. Ce défi nécessite une approche agile, systémique et de long terme.
Or, les programmes de promotion de la contraception ciblent majoritairement les femmes. Pourtant, dans une société encore largement marquée par un modèle patriarcal, n’est-il pas temps de mettre davantage l’accent sur l’implication des hommes ? Et pourquoi ne pas encourager aussi l’adoption des méthodes contraceptives masculines, encore très peu valorisées ?
Au Niger, par exemple, les « Écoles des maris » ont démontré leur efficacité. En plaçant les hommes au cœur des discussions sur la santé reproductive, ces écoles ont permis de changer les mentalités, de réduire la résistance masculine et d’augmenter l’usage des méthodes contraceptives dans plusieurs communautés. Ce programme montre que mobiliser les hommes comme alliés, et non comme obstacles, peut contribuer à faire émerger une intelligence collective au service de la santé des femmes.
Chez Africitizen, nous mettons la participation citoyenne et les données au service du développement durable. Vous avez besoin d’appui pour organiser des dialogues communautaires, collecter des données sur la contraception/santé reproductive, ou produire des analyses utiles à la décision ? Nous serons très heureux d’en discuter avec vous.
Ensemble, faisons évoluer les perceptions sur la contraception, et construisons un avenir où chaque décision reproductive est éclairée, libre et respectée.
Par Gérald AMAHOWE | Analyste en innovation sociale à Africitizen | Juin 2025
Références
- Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) et ICF International. (2011). Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2011–12. Calverton, MD, États-Unis : ICF International et Cotonou, Bénin : INSAE, 2013.
- FASSASSI Raïmi (2007). Les facteurs de la contraception en Afrique de l’ouest et en Afrique centrale au tournant du siècle. Paris-France : CEPED, 67 pages.
- MSOMA Bruno et TADJIDINE Steve Franck (2005). Etude sur les causes d’abandon de la planification familiale. Vice-présidence chargée du Ministère de la Solidarité, de la Santé, de la Population, de la Condition Féminine du travail et de la Réforme Administrative. DSF 2005 ; 16-19p.